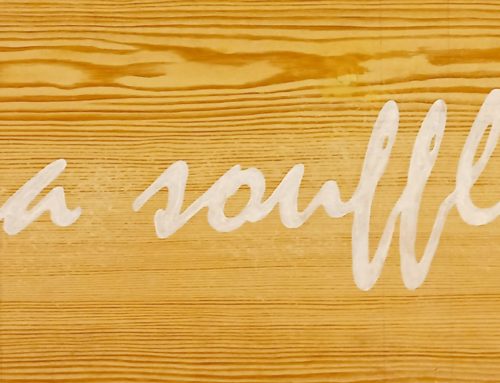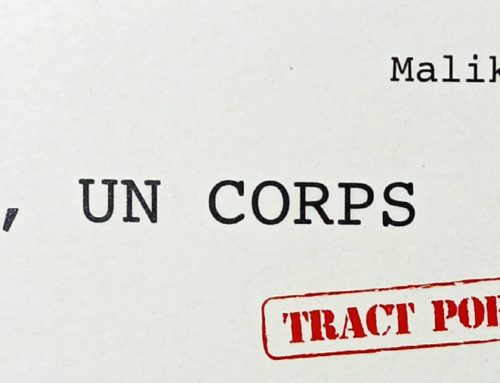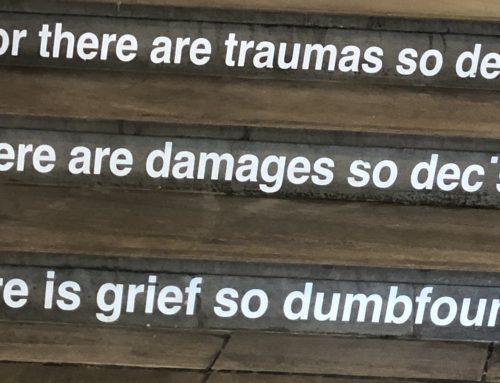Le châssis, la croix.
La toile est traditionnellement clouée sur le bois comme un corps sur la croix. Le bois soutient le tissu mais aussi l’écartèle, le raidit, le tend.
Chez Buraglio, le montage des divers constituants du tableau déplace les rapports. La partie souple – filet de cagette, bâches et textiles divers – s’affranchit parfois du support et devient structurante. La part rigide – bois, contreplaqué, carton, tôle, verre – fait fonction de motif ou de support selon qu’elle est placée devant ou derrière le châssis si châssis il y a. Les rôles ne sont pas fixés et les matériaux employés sont multiples.
Crucifixion [1] de Philippe de Champaigne. Une scène quasiment frontale, centrée sur le crucifié avec le paysage en contrebas. L’intensité de l’instant est plus portée par la gamme chromatique que par les lignes et la composition. Le tableau est en effet équilibré, séparé en deux par la croix. La lumière se diffuse autour, creuse l’espace dans la trouée qui pointe derrière le Mont Golgotha, peine à lever le couvercle de plomb posé sur le calvaire et se fige sur le corps. A dominante bleuté, elle produit l’effet dramatique.
Buraglio dans le Dessin… d’après Philippe de Champaigne. Crucifixion [2] de 1979 ne retient de l’œuvre que les lignes, en évacuant toute sensibilité. Il dématérialise le corps du Christ par le tracé segmenté des contours mais souligne en revanche d’un double trait appuyé ce qui correspond dans le tableau du maître au passage du clair à l’obscur. Ce contraste, linéairement réduit, devient encadrement. Territoire connu !
La croix, croisée de fenêtre.
C’est le même thème qu’il va chercher chez Delacroix – coup double, le nom du peintre confirme le choix. Le Christ sur la croix [3]de 1833, entre chemin de croix et crucifixion, offre une mise à mort magnifiée par l’éclairage. Déjà s’annonce la résurrection. Tous les temps s’abîment en cet instant. La périphérie parle de ce qui précède : à gauche la croix que des hommes redressent, à droite l’échelle que l’on s’empresse de faire disparaître. Le centre fixe le présent – apaisement du crucifié transfiguré, regard de Marie-Madeleine tenu, tendu par la sidération. Le premier plan évoque la suite : deux femmes s’éloignent déjà. Parmi elles, la Vierge offre au spectateur son visage souffrant, prolongeant ainsi la douleur qui a quitté celui du fils.
L’intérêt pour les lignes de construction est manifeste dans Nom de peintre : le nom d’après… Delacroix, variation I/IV [4] et variation III/IV de 2012.[5] Ne reste du modèle que l’échelle à droite et les trois croix qui, débarrassées des corps, n’en semblent plus qu’une, à trois moments de son élévation. L’échelle n’a rien à voir avec la scène finale saisie à l’instant crucial où l’humain rejoint le divin – ce que par ailleurs la croix symbolise. L’échelle renvoie au labeur. Elle témoigne du travail des hommes, paradoxalement rassurant dans sa banalité même et qui pourtant nous rend la mort plus proche. L’échelle, les trois croix, les carreaux de la feuille et les lignes directrices, parlent du cadre dans lequel le supplice va se dérouler, de sa préparation, du chantier, d’un avant.
Buraglio se débarrasse du spectaculaire en retenant, au-delà de la scène représentée, les premiers traits, ceux qui fixent l’idée dans ses prémices. Il est question de la fabrication de l’œuvre, de la genèse même du tableau. Tracés jetés sur la feuille, lignes de forces, inscription des masses, hachures colorées, le rouge et le noir, contraste maximal, le sang, la mort. Les croix mises en perspectives mais ramenées à la surface par un tracé géométrique, les indications de volume et de lumière signalées par le renforcement de certains traits. Le rendu linéaire aplatit presque tout. Jusqu’à la mise au carreau du papier, dans la version au support quadrillé, qui contrarie une éventuelle tentation de profondeur plastique. Seule subsiste la superposition des papiers agrafés ou collés en guise de relief ténu mais bien réel et la matérialité des agrafes. Plus de hiérarchie, pas d’instant culminant, le centre n’est pas plus important que les bords, pourtant ce qui est montré est tout aussi essentiel. Ce que l’artiste met au jour c’est la construction du décor.
Sommaire mais efficace !
Et ce faisant il retrouve tout entier contenu là, son propre vocabulaire : la croix, le châssis, l’échelle… Structurer, retrouver la charpente, ce qui permet de tenir droit, de tordre aussi, de déplacer, de plier, de coucher.
La fenêtre, une croix dans un cadre.
Le cadre borde. Il définit les contours, aménage un dedans et un dehors, limite l’espace.
La fenêtre ouvre vers l’extérieur, laisse entrer la lumière dans un volume. Elle est fermée ou ouverte. Le regard la franchit sans que le verre ne l’arrête, pour se perdre dans les lointains.
La croix partage. Elle n’opère pas un mouvement horizontal d’ouverture vers le paysage ou, inversement, de coup d’œil jeté sur l’intimité d’une pièce, c’est un mouvement d’une verticalité définitive. Moins franchissement répété que passage radical. La verticale, bordée à son sommet dans la fenêtre, traverse l’horizontale, la perce, la troue, pour poursuivre son inexorable ascension vers le ciel transformant le T en croix.
Ce qui est contenu d’un côté est absolu de l’autre.
La Fenêtre [6] de 1982 témoigne de cette impossibilité d’un dépassement. Les montants supérieurs de la croisée, fermés, bornent l’œuvre qui se déploie au-dessous dans la transparence de deux verres affrontés. Une dualité simple qu’affirme l’opposition verticale/horizontale, verre incolore/verre bleu. Un parfait équilibre qui atteste pourtant d’une ambigüité : la fenêtre est fermée mais elle n’enferme plus. Elle prend l’air de toutes parts. Le cadre a disparu. La fermeture, s’il en est, ne persiste que dans la jointure des deux montants maintenus ensemble par le tour donné à la poignée et par cette barre qu’ils forment au sommet. L’œuvre ne se déploie pas au-delà mais en deçà. Déjà Montage[7]en 1978 présentait la même composition : une structure en T composée de fragments de pages de journal caviardées posées devant un filet de cagette bleu. Même radicalité. Le texte raturé en rouge – le verbe et le sang – et derrière en voile léger- celui de la Vierge ou bleu du ciel – la résille. Quadrillage distendu et partiellement déchiré. Une proposition toute en fragilité, comme esquissée, à côté de laquelle Fenêtre parait définitive. Mais en dépit de l’apparente simplicité des deux, l’une n’est pas le travail préparatoire de l’autre. Si quelque chose de semblable se joue dans la structure, tout diffère et pas seulement dans l’évidence des matériaux utilisés. Ce qui dans l’œuvre de 1982 se déroule dessous, se joue avant tout derrière dans celle de 1978. L’écriture sert de support au trait rouge qui la rend illisible. Le fin réseau bleu ne vient pas s’inscrire sur la croix en place du corps supplicié dont il pourrait déjà affirmer la dématérialisation glorieuse, mais en arrière comme un fond aérien sur lequel se déroule la scène. Renversement des rapports dont témoigne aussi le choix d’utiliser les morceaux découpés du journal, permutés à 60 ° pour la barre verticale et à 90° pour la barre horizontale, histoire de compliquer la lecture. Reste donc cette trame de fins traits rouges en colonnes juxtaposées, plus ou moins justifiées, qui reconstitue presque sous nos yeux le réseau artériel d’un corps sanglant.
Le corps en croix, la croix, la lettre.
TXT, Lettrine, 1980.[8] Le T et la croix. Pas la croix verticale du Christ, croix catholique à l’élan vertical, mais celle oblique du X, aux branches égales, croix de Saint André. Croix qui placée entre, relie et multiplie ; placée sur, rature, raye, fait disparaître partiellement, annule sans pour autant effacer. Référence à la revue TXT[9], mais probablement aussi à Textruction[10] – la pratique du caviardage est récurrente chez Buraglio comme elle l’est chez certains membres de ce groupe.
Dans ce collage sur papier l’artiste décline trois propositions qui s’échelonnent sur la page. Double rythme ternaire, trois fois trois, trois au carré. Toutefois, de carré il n’est pas. Chaque proposition s’inscrit plutôt dans un rectangle qui prend place sur le support, lui-même rectangulaire. Page d‘écriture ou surface à peindre ? La première proposition est tout entière tracée et peinte. La deuxième à la fois peinte, découpée et agrafée. La croix vient partiellement recouvrir les T, un papier découpé noir donne forme à l’espace interstitiel. La troisième proposition juxtapose une partie peinte en T et deux compositions inscrites chacune dans un rectangle, une structurée par le T, l’autre par le X, rapportées et fixées par des agrafes.
S’agit-il d’une entreprise de destruction du texte dans la parenté des biffures? Destruction du tableau par le texte ? Du tableau pour le texte ? Du texte pour construire le tableau ? Ou simplement de confrontation ? Signes linguistiques et formels cohabitant pour interroger encore et encore la capacité expressive des lignes et des couleurs, leur aptitude à produire du sens autant qu’à s’en défaire. Le texte ici réduit à sa plus simple expression, celle qui rejoint le châssis, la verticale, l’horizontale et l’oblique.
Le T et le X, la croix, le cadre, la fenêtre, le montant, le mur….
Destruction de la chair pour faire apparaître l’os, l’ossature, le squelette. Recouvrir, découper, remonter pour dévoiler.
Les œuvres de Buraglio sur les cimaises du Musée d’art moderne de Saint-Etienne révèlent dans leur déploiement une formidable capacité à travailler la construction des espaces jusqu’à l’accrochage même qui fait des cimaises, de leurs arêtes et de leur surface, le support de nouveaux agencements. Dans chaque salle se vérifie non seulement le pouvoir structurant du travail mais aussi sa délicatesse. La présentation est pensée toute en légèreté. Chaque mur proposant un équilibre particulier dont la fragilité garantit le dynamisme. La couleur y est sans débordement, douceur et tendresse, toujours accordée.
[1] Philippe de Champaigne, Le Christ mort sur la croix, 1655, huile sur toile, 227 x 153 cm, Musée de Grenoble.
[2] Pierre Buraglio, Dessin d’après… Philippe de Champaigne. Crucifixion, 1979, repris en 1982, crayons de couleur sur papier calque, 114, 1 x 94, 3 cm, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Centre de création industrielle, Paris. Catalogue Pierre Buraglio Bas voltage (1960-2019), Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Etienne Métropole, éd° Fabelio, 2019, p 130
[3] Eugène Delacroix, Le Christ sur la croix ou Le calvaire, 1835, huile sur toile, 182 x 135 cm, Musée de La Cohue, Vannes.
[4] Pierre Buraglio, Nom de peintre : le nom d’après… Delacroix, variations I/IV, 2012. Tirage numérique sur papier quadrillé agrafé sur papier quadrillé. Studio Bordas, 80 x 55 cm, Musée des beaux-arts, La Cohue, Vannes. Ibid., p 120.
[5] Pierre Buraglio, Nom de peintre : le nom d’après… Delacroix, variations III/IV, 2012. Tirage numérique sur papier calque, papier vert collé et papier calque agrafé. Studio Bordas, 72 x 58 cm, Musée des beaux-arts, La Cohue, Vannes. Ibid., p 121.
[6] Pierre Buraglio, Fenêtre- 1982, bois et verre incolore et bleu, 105x100cm, collection CAPC – Musée d’art contemporain, Bordeaux. Ibid., p102.
[7] Pierre Buraglio, Montage, 1978, page de journal caviardée et filet de cagette, 69 x 54 cm, Librairie Ravy, Quimper. Ibid., p 131.
[8] Pierre Buraglio, TXT Lettrine, 1980, collage sur papier, 102 x 65 cm, collection particulière. Ibid., p 132.
[9] TXT est une revue littéraire fondée en 1969 à Rennes par Christian Prigent et Jean-Luc Steinmetz.
[10] Textruction, groupe d’artistes constitué par Georges Badin, Jean Mazeaufroid, Gérard Duchêne, Gervais Jassaud, Michel Vachey [10] en 1971.